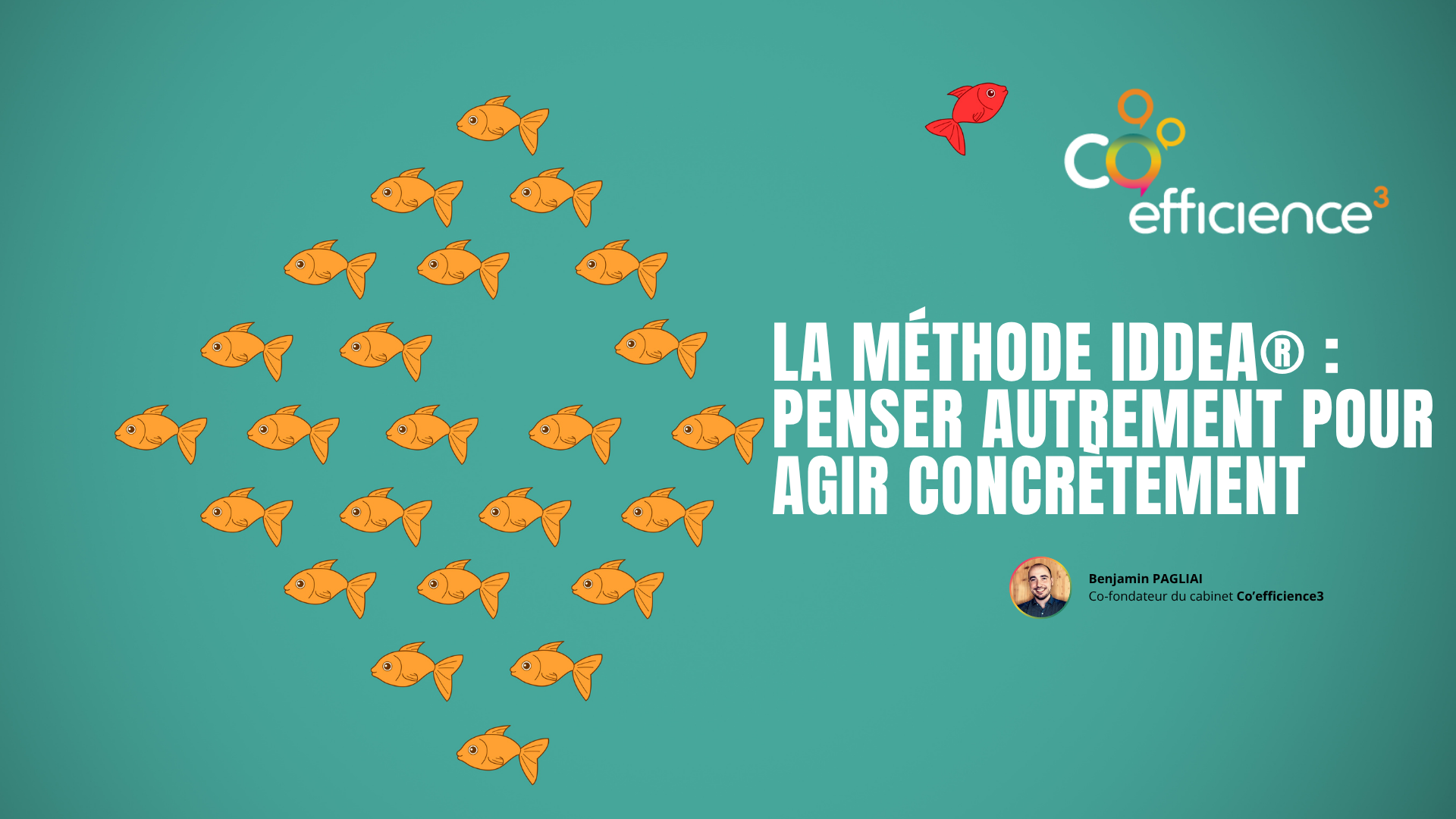
Accueil > Nos thématiques > Méthodes à découvrir > Plaidoyer pour le post-it : ce petit carré mal-aimé.
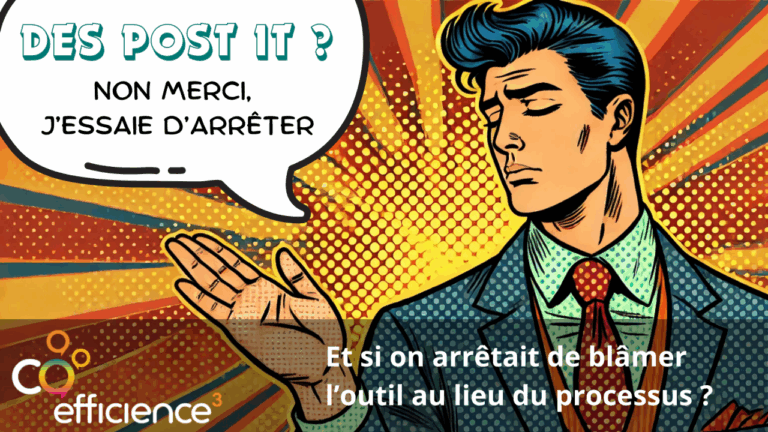
Non, ce qui vient d’être tué à coups de sarcasmes et de grimaces sceptiques, c’est le post-it. Ce petit carré de papier coloré, collé à toutes les sauces sur les murs des salles de réunion, est devenu le bouc émissaire parfait des démarches collaboratives jugées vaines ou gadgetisées.
Vous avez sûrement déjà entendu un de vos collègues souffler : « Encore un atelier post-it… à la fin, on en fera des confettis pour les vœux de fin d’année. » Ou ce grand classique du consultant désabusé : « Un brainstorming, c’est 50 post-it, 10 idées recyclées et 0 décision prise. »
Et s’il n’y avait pas de mauvaises idées, juste des processus mal conduits ?
À force d’ateliers bâclés, d’animations sans finalité et de murs bariolés sans lendemain, le post-it a été condamné. Mais pas pour les bonnes raisons. Ce n’est pas l’outil qui est en cause. C’est l’absence de méthode, de cadre et d’intention.
Car soyons clairs : le brainstorming raté n’est pas une affaire de papeterie. C’est une affaire de facilitation. Et, dans la mauvaise pièce, même une Stradivarius sonnera faux.
Le plus ironique ? La science, elle, ne boude pas le post-it.
Une étude menée par Randy Garner, professeur de psychologie comportementale, a démontré que les demandes accompagnées d’un simple post-it manuscrit obtenaient jusqu’à deux fois plus de réponsesque celles sans note. Ce petit geste, apparemment anodin, crée un effet de proximité, d’attention, de personnalisation — un ancrage émotionnel puissant. Venir poser son post it c’est aussi se responsabiliser, s’engager, assumer son idée et être un acteur du changement étudié. Se mettre en mouvement favorise également le dynamisme de la phase d’idéation des démarches collaboratives.
👉 Source : Garner, R. (2005). Post-it® Note Persuasion: A Sticky Influence. The Journal of Consumer Psychology.
Mais ce n’est pas tout. Les post-it stimulent aussi des fonctions clés de notre cerveau :
C’est peut-être ici que réside le vrai super-pouvoir du post-it.
Dans un monde saturé d’informations, d’interruptions, de sollicitations multiples, le simple fait d’écrire une idée lui donne une chance d’exister. Ce petit carré, c’est une scène. Une tribune. Une vitrine. L’idée qui y figure quitte le monde du flou pour entrer dans celui du partage.
Et dans l’intelligence collective, l’idée est la matière première. Pas de matière, pas de co-création.
Utilisé avec méthode, le post-it devient un outil de design de la pensée.
C’est ce qu’on retrouve dans les démarches de design thinking, de sprint d’innovation, de kanban visuel. Le post-it structure l’invisible, rend palpable le chaos créatif.
Non, on ne vous demande pas de repeindre vos murs en fluo. Oui, on vous demande d’arrêter de mépriser ce qui, bien utilisé, peut faire naître les meilleures idées.
Voici quelques principes simples pour lui rendre ses lettres de noblesse :
Chez Co’efficience3, cette conviction se traduit par des parcours de formation sur mesure, centrés sur ce que Benjamin Pagliai appelle la combinaison gagnante : méthode, outils, posture. Loin des solutions standardisées, chaque accompagnement s’ajuste aux réalités du terrain et aux défis des équipes. Ce travail fin et exigeant permet d’enraciner des pratiques réellement transformatrices.
Le collaboratif n’est pas une mode managériale, c’est une réponse à la complexité du monde du travail, une manière concrète d’outiller les managers pour faire face aux enjeux contemporains. Redonner aux équipes le pouvoir d’agir, de comprendre et de contribuer pleinement : voilà ce que permet une culture managériale centrée sur l’intelligence collective. Et c’est là que commence l’engagement.
Article rédigé par Benjamin PAGLIAI , Cofondateur du cabinet Co’efficience 3