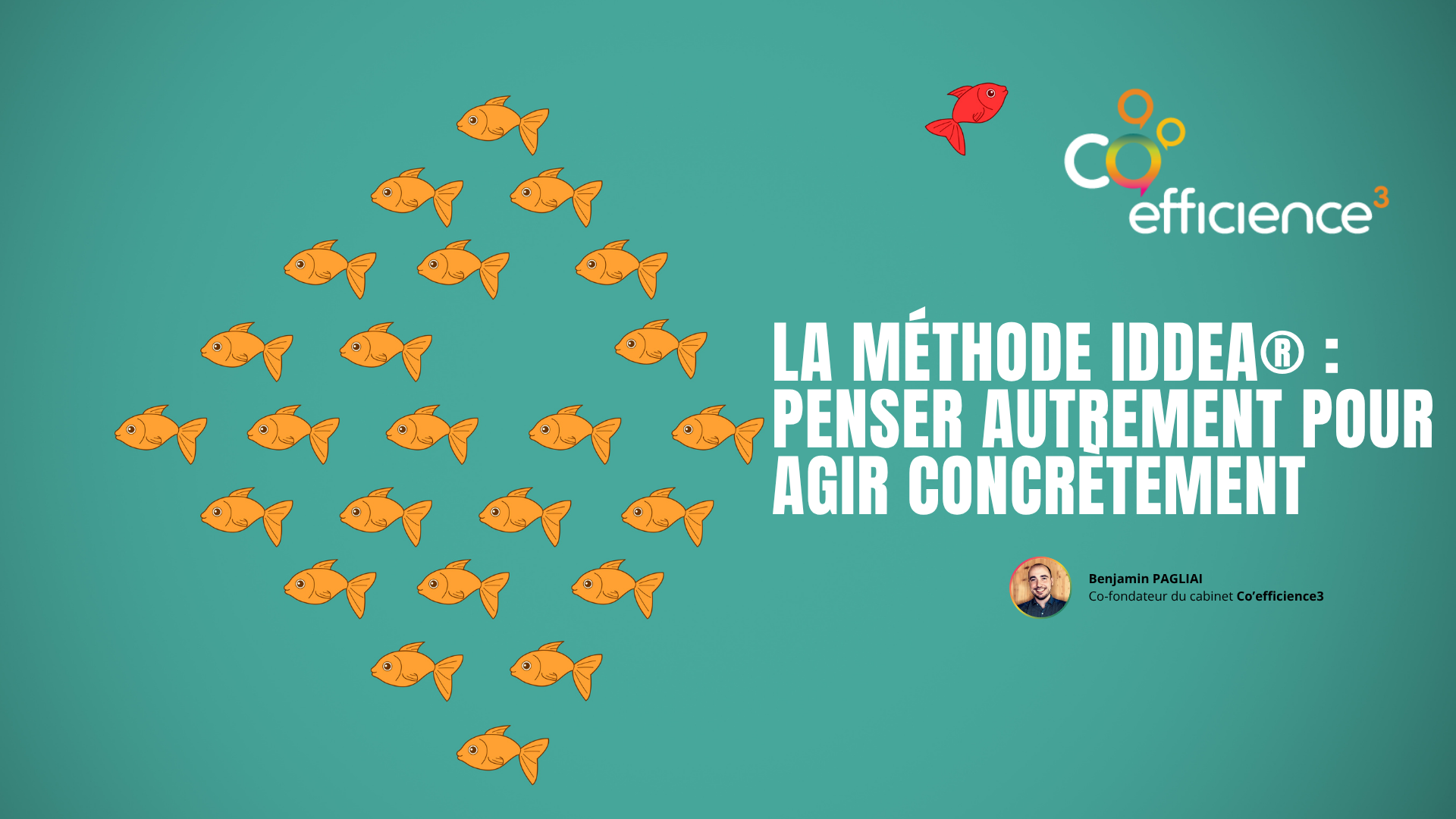
Accueil > Nos thématiques > Actualités du secteur > Pratiques managériales en Europe, quand l’IGAS fait son rapport.
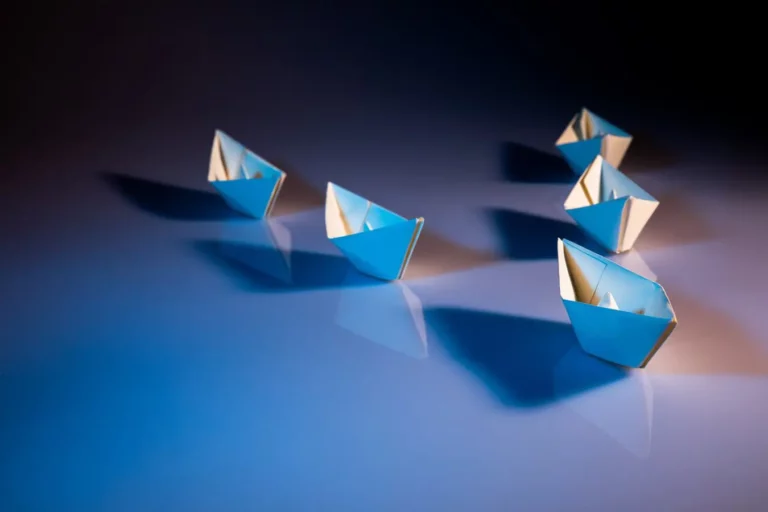
Quels sont les liens entre les pratiques managériales, la performance des entreprises, la qualité de vie au travail et les politiques sociales nationales ? Cette question est au cœur de l’étude menée en 2024 par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Publié il y a quelques semaines, le rapport et ses conclusions font état d’un consensus quant à la vision du bon management et pointent du doigt le retard de la France.
Alors que l’étude de l’IGAS s’est intéressé à cinq pays et quatre secteurs d’activités – automobile, hôtellerie-restauration, digital et assurance – le premier constat et étonnement que cette enquête révèle est l’existence d’un consensus européen sur le management efficace..
La participation active : au cœur de l’engagement Le premier pilier concerne l’implication systématique des collaborateurs dans les processus de décision. Les entreprises européennes les plus performantes ont intégré cette dimension comme un standard opérationnel, non comme un « plus » optionnel. Cette participation ne se limite pas aux grandes orientations stratégiques, mais s’étend aux décisions opérationnelles quotidiennes qui impactent directement le travail des équipes.
L’autonomie accompagnée : l’art de l’équilibre Le deuxième fondamental repose sur un subtil équilibre entre autonomie et accompagnement. Les managers européens performants ont appris à déléguer sans abandonner, à faire confiance tout en restant disponibles. Cette approche, loin d’être spontanée, résulte d’une véritable transformation du rôle managérial vers une posture de facilitation et de développement.
La reconnaissance : un levier sous-exploité Enfin, la reconnaissance du travail accompli constitue le troisième pilier. Au-delà de la dimension financière, cette reconnaissance prend des formes multiples : valorisation des compétences, feedback constructif régulier, visibilité des contributions individuelles et collectives.
Alors que AXA valide leur dossier de reprise, Laetitia et Emmanuel font finalement un autre choix : à cette agence existante, ils préfèrent la création de leur propre structure à savoir, la fusion de leurs agences existantes. En septembre 2020, ils se lancent et présentent leur ambition commune à l’ensemble de leurs salariés. Le premier séminaire d’équipe animé par Co’Efficience3 sera notamment l’occasion de trouver le nom de leur Agence AXA : EG2L.
“ Nous avons travaillé ensemble pour atteindre notre ambition : Faire partie des leaders en France ”, poursuit madame Loll. Pour atteindre un tel objectif, rien n’est à laisser au hasard. Les nouveaux associés croient dans le travail d’équipe et l’intelligence collective et, avec leurs collaborateurs, ils structurent le projet autour de trois axes : positionnement stratégique, développement commercial et cohésion d’équipe.
Ils savent que des évolutions seront nécessaires aussi, lors de ce premier séminaire, ils invitent leurs collaborateurs à élaborer la feuille de route de cette aventure commune.
L’analyse comparative s’arrête sur des spécificités managériales françaises, qui la distinguent, pas toujours favorablement, de ses voisins européens.
Une verticalité persistante
Les pratiques managériales françaises demeurent marquées par une approche plus verticale et hiérarchique. Cette caractéristique se manifeste par des circuits de décision longs, une centralisation excessive du pouvoir et une communication descendante prédominante. Alors que ses voisins européens expérimentent des organisations plus horizontales et agiles, la France semble encore attachée à des modèles pyramidaux traditionnels.
Un déficit de reconnaissance
L’étude met en évidence un niveau de reconnaissance au travail significativement plus faible en France. Ce constat interpelle, car la reconnaissance constitue l’un des leviers les plus puissants de motivation et d’engagement. Cette lacune française explique en partie certains maux récurrents : démotivation, turnover élevé dans certains secteurs, difficultés de fidélisation des talents.
Une formation managériale déconnectée
La formation des managers français apparaît trop académique, insuffisamment connectée aux réalités opérationnelles et aux enjeux humains du management moderne. Pendant que d’autres pays développent des approches de formation plus pratiques et expérientielles, la France reste souvent prisonnière d’un modèle théorique qui prépare mal aux défis managériaux contemporains.
Pour transformer en profondeur les pratiques, les entreprises ont besoin de soutien et d’un cadre clair. L’IGAS appelle à une politique publique plus structurée et elle souligne que l’évolution doit se jouer dans les entreprises, par la formation continue, l’expérimentation, l’analyse de pratique, le travail collaboratif. Le développement des compétences managériales doit s’ancrer dans des démarches vivantes, apprenantes, ancrées dans le réel. De nombreuses solutions s’offrent à elles :
– Former au leadership collaboratif, au sens du collectif, au pilotage hybride ;
– Déployer des séminaires de co-construction pour clarifier les rôles et aligner les équipes ;
– Accompagner les managers dans leur posture tout au long de leur vie professionnelle.
Il ne s’agit pas d’ajouter une « case managériale » dans un référentiel RH, mais bien de transformer les organisations en les rendant plus humaines, plus durables, plus efficaces. C’est tout le projet d’une entreprise apprenante. On en parle ?